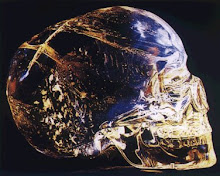Comme tout le monde j'ai appris à l'école que nous devons à Pasteur la découverte des bactéries et la démonstration que les êtres vivants ne naissent pas spontanément, contrairement à ce que l'on croyait depuis Aristote. La réalité historique est bien entendu plus complexe et plus intéressante.
Tout d'abord Pasteur est loin d'être le premier savant à réfuter la thèse de la génération spontanée. En 1668, un riche apothicaire italien de la cour des Médicis, Francesco Redi, avait déjà démontré avec une rigueur scientifique tout à fait inédite pour l'époque, que les asticots ne naissaient pas tout seuls dans la viande. Pour y parvenir, il remplit des fioles de viande et de poisson mort, et en couvre certaines d'une fine gaze tandis que les autres sont laissées ouvertes à l'air libre. Au bout de quelques jours, il trouve des asticots mais uniquement au fond des fioles ouvertes, dans lesquelles des mouches ont pu s'introduire et y pondre des oeufs. Il n'y a pas d'asticot dans les autres fioles. Mais sur la gaze qui les recouvre, il découvre les oeufs que les mouches ont déposés, attirées par l'odeur de la viande. A ce pionnier de la démonstration expérimentale, on a dédicacé un cratère sur Mars.
Pasteur n'est pas non plus le premier à découvrir les bactéries. A peu près à la même époque que Redi, Antonie Van Leewenhoek un drapier hollandais et bricoleur de génie, publie en 1678 ses observations d' "animacules" minuscules (des protozoaires et des bactéries) grâce à ses microscopes de sa fabrication qui grossissaient jusqu'à 200 fois, une prouesse pour l'époque. Amateur de génie en dehors des circuits scientifiques de l'époque, Van Leewenhoek observe avec son microscope les globules rouges, les spermatozoïdes, l'anatomie de nombreux insectes, la structure des végétaux...
Enfin, dans sa controverse avec Pouchet, Pasteur n'a pu réfuter convenablement la contre-expérimentation de ce dernier, qui observa la naissance de microbes dans une infusion de foin pourtant bouillie scellée. Pasteur a d'ailleurs lui-même reproduit cette expérience avec succès et n'a pas publié ses résultats qui viennent contredire son édifice théorique: "Je ne publierai pas ces expériences, écrit-il, (...) les conséquences qu'il fallait en déduire étaient trop graves pour que je n'eusse pas la crainte de quelque cause d'erreur cachée." Heureusement, en 1870 l'Académie des sciences est déjà acquise aux thèses de Pasteur et enterre définitivement la théorie de la génération spontanée dont Pouchet est le dernier défenseur jusqu'à sa mort, deux ans plus tard.
Ce n'est qu'en 1876 que l'on résoudra l'énigme de l'expérience de Pouchet: à très haute température le bacille du foin se transforme en spore très résistante, et retrouve ensuite sa forme vivante au contact de l'oxygène.
Bref, sur cette question de la génération spontanée, Pasteur a surtout été l'avocat efficace d'une théorie déjà bien en vogue. Il ne prouvera son génie que plus tard, avec la découverte de la la stérilisation (qui est la conséquence des expériences précédentes) et bien sûr avec l'invention du premier vaccin.