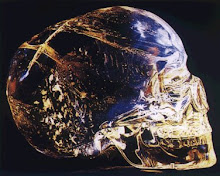Rappel des épisodes précédents (ici): les innovations technologiques et les ramifications du vivant présentent d’étranges similitudes. Les délais entre deux évolutions majeures sont de plus en plus courts et semblent suivre une progression logarithmique. Quelle que soit la manière dont on représente de telles évolutions -graphe, arbre ou autre- la forme obtenue est toujours la même, quelque soit l'échelle choisie. Ce sont donc des fractales! De quoi combler les amateurs de Da Vinci Code... Certes, ce n’est pas un scoop de dire que l’histoire du progrès technique s’accélère à mesure que le temps passe, mais c’est plus surprenant de faire le même constat pour les chronologies du vivant:
Source : Chaline, Nottale et Grou (ici)
Je viens de trouver une explication plus simple à ce phénomène que celle des lapins-sauteurs de mon précédent billet, en lisant un excellent bouquin de Jared Diamond dont je vous reparlerai dans un prochain billet.
L'imprimerie, inventée il y a 3700 ans...
La réponse de Diamond est finalement assez évidente : aucune innovation, aussi géniale soit-elle, ne peut se diffuser si elle ne se s’articule pas avec les technologies existantes. Il n’y avait en Crète ni encre, ni papier, ni presse, ni métal, ni écriture alphabétique pour que cette invention « prenne ». Et comme seuls quelques scribes jaloux de leur pouvoir savaient à l’époque lire et écrire, il n’y avait pas besoin de diffuser massivement de l’information. L’imprimera attendra donc que tous les ingrédients soient réunis dans l’Europe de Gutenberg pour trouver son essor en 1455 et modifier considérablement le cours de l’histoire occidentale.
Derrière chaque invention, une armée de précurseurs méconnus
Thomas Edison a breveté la version moderne de l’ampoule électrique et Samuel Morse celle du télégraphe électrique mais dans les deux cas, leurs inventions ont été précédées de nombreux procédés similaires ou concurrents (voir par exemple cette histoire de l’éclairage et celle du télégraphe).
Une innovation ne réussit donc que lorsqu’elle coïncide avec un bon contexte technologique, prêt à la faire fructifier. Un peu comme un nouveau réactif chimique, qui ne produit d'effet intéressant que lorsqu’il est incorporé aux bons ingrédients.
L'innovation: une affaire de combinatoire?
Innover serait donc l'art de combiner astucieusement des idées ou des technologies. D'ailleurs, la créativité n'est-elle pas précisément la capacité d'associer deux concepts qui n'ont pas l'habitude de l'être? Cette relation intime entre innovations et combinaisons pourrait expliquer le caractère cumulatif du progrès technique, dont les effets se multiplient plutôt qu’ils ne s’additionnent. Plus on a d’ingrédients à sa disposition, plus on a de chances de trouver le mélange adapté à un nouveau réactif. Plus une société a accumulé de technologies, plus elle a les moyens de tirer parti d’une innovation. Le progrès technique progresse donc en cascade, une innovation en amenant une autre dans des délais de plus en plus courts.
[Pour les sceptiques uniquement, essayons de modéliser ça. Supposons que l’on dispose de n technologies et que le champ des innovations soit proportionnel au nombre de combinaisons possibles entre ces technologies. Il y a alors 2n combinaisons possibles (voir la démonstration ici). Une technologie supplémentaire double le nombre de combinaisons donc le champ des innovations].
L’invention de l’internet par exemple, n’a pris son ampleur qu’avec l’avènement de l’ordinateur individuel et la démocratisation du haut-débit. A son tour, l’internet a permis l’invention de nouvelles formes de divertissement, de commerce, de communications, de moyens de paiement qui elles-mêmes ont induit d’autres innovations etc.
Le Scrabble du vivant
Il y a sans doute quelque chose du même genre dans le grand Lego du vivant. Lorsqu’une innovation anatomique réussit (un nouveau plan d’organisation au Cambrien par exemple), elle ouvre la voie à une floraison de recombinaisons qui chacune amène de nouvelles espèces.
Contrairement au progrès technologique qui ne connaît comme limite que celles que lui impose notre culture, l’évolution du vivant, est, elle, soumise à de nombreuses limites physiques: en termes de taille, de poids et de proportion par exemple, mais il y en a beaucoup d’autres. Il se passe donc à mon avis la même chose qu’au Scrabble:
Des Scrabbles partout...
L’innovation culturelle serait-elle plutôt Scrabble ou plutôt Légo? Paradoxalement, il me semble qu’elle est plutôt Scrabble, en raison des contraintes culturelles qui délimitent le plateau de jeu. Le jazz par exemple, a ouvert la voie à de nombreuses écoles qui se sont multipliées jusqu’à ce qu’on ait progressivement exploré toutes les combinaisons culturellement intéressantes. Sans doute faudra-t-il attendre un ingrédient supplémentaire (technologique ou culturel) pour que foisonnent (peut-être?) de nouveaux styles.
Source: article d'Ivan Brissaud (ici)
Si mon hypothèse tient la route, il n'est pas très étonnant de trouver autant de phénomènes humains, physiques ou biologiques obéissant à des lois log-périodiques: on en obtient chaque fois qu'une dynamique combinatoire est à l'oeuvre et que son développement est entravé par une contrainte. Cette "invariance d'échelle" omniprésente dans la nature est bien sûr fascinante et l'on peut être tenté d'y rechercher LA règle universelle de l'ordre naturel comme le font certains chercheurs. C'est à mon avis faire beaucoup d'honneur à l'analyse combinatoire. Je reste en revanche toujours impressionné par la beauté du résultat, obtenu à partir de règles aussi élémentaires que celles du Scrabble.
Sources:
De l’inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond
Billets connexes:
Innovation et évolution: une histoire de lapins-sauteurs?
La Reine, le Fou et l'Arbre